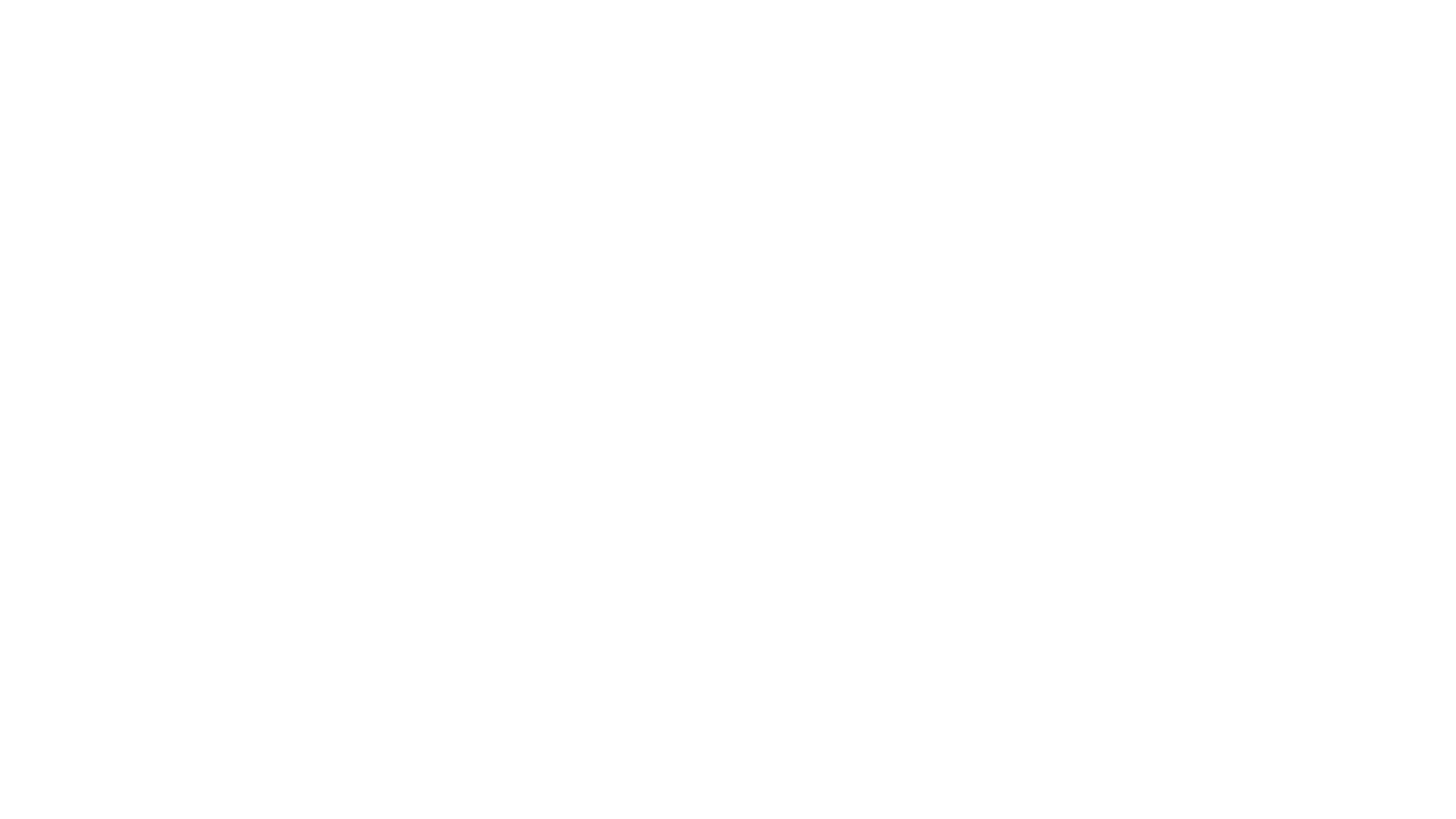Le risque existentiel : entre légitime défense et dérive préventive
Imaginez un monde où l’on justifie l’irréparable non parce que c’est nécessaire, mais parce que « ça aurait pu l’être ». Ce monde, c’est déjà le nôtre.
Le concept de risque existentiel — c’est-à-dire une menace pesant sur la survie même de l’humanité — a quitté le champ scientifique ou philosophique pour devenir un argument politique, policier, militaire. Et dans cette mutation, il est en train de devenir une doctrine justifiant l’extrême, au nom d’un futur hypothétique.
Quand l’exception devient la norme
À l’origine, les risques existentiels renvoient à des menaces réelles : changement climatique, guerre nucléaire, pandémies, effondrement de la biodiversité, intelligence artificielle hors de contrôle. Mais dans la bouche de certains gouvernants, le terme dérive : il devient une justification préventive pour des politiques de surveillance, de répression, de guerre.
Agir non plus sur ce qui est, mais sur ce qui pourrait arriver.
On ne protège plus les populations d’un péril objectif : on construit une architecture de contrôle pour éviter un danger que l’on redoute, que l’on projette, que l’on fantasme.
Et si nous agissions tous ainsi ?
Posons la question autrement : si chacun appliquait la logique du « risque existentiel » à son quotidien, il deviendrait rationnel de frapper son voisin, non pas parce qu’il est dangereux, mais parce qu’il pourrait le devenir. C’est absurde ? C’est pourtant déjà une réalité.
L’affaire Nahel, abattu à bout portant lors d’un contrôle routier à Nanterre, en est une démonstration crue. Le jeune de 17 ans n’était pas armé. Il fuyait. Il n’a pas tenté d’écraser les policiers. Pourtant, l’un d’eux a tiré. Pourquoi ? Parce qu’il aurait pu mettre d’autres vies en danger s’il redémarrait.
On ne réagit plus à une menace : on agit sur l’hypothèse d’une menace.
On ne prévient plus un crime : on le remplace par une exécution préventive.
Et cette logique, une fois validée à l’échelle de l’État, devient doctrine.
Le principe de précaution détourné
Il ne s’agit plus ici du principe de précaution au sens écologique — prendre des mesures en cas de doute sérieux. Non. Il s’agit de fabriquer des décisions radicales à partir de scénarios imaginaires. On ne gouverne plus en fonction du réel, mais à partir d’un récit de la peur.
Et ce récit se répète :
– Le migrant pourrait être un terroriste.
– Le militant pourrait devenir violent.
– L’adolescent pourrait représenter un danger public.
– L’État ennemi pourrait nous frapper un jour.
Dans chacun de ces cas, la violence préventive devient « légitime », parce qu’elle est enveloppée d’urgence morale, de responsabilité sécuritaire, de raison d’État.
Une démocratie sous tension permanente
En légitimant la frappe préventive, l’exception sécuritaire devient une norme administrative. Surveillance généralisée, lois d’exception, criminalisation de l’intention : tout devient justifiable si l’on invoque le bon scénario catastrophe.
Mais cette mécanique ne protège pas la démocratie. Elle la mutile. Car une démocratie vivante repose sur le débat, l’incertitude, le dissensus. Pas sur la projection paranoïaque et le fantasme de contrôle total.
Et demain ?
Demain, ce pourrait être une IA qui juge les comportements « à risque », un algorithme qui décide qui est trop imprévisible pour avoir des droits.
Le rêve de tout pouvoir autoritaire : ne plus attendre l’acte pour punir.
Survivre à tout prix, mais pour vivre comment ?
Le risque existentiel, s’il est réel, doit être pris au sérieux. Mais il ne peut servir d’alibi à l’arbitraire, ni de paravent à la brutalité.
Si nous devons survivre, ce n’est pas en sacrifiant ce qui fait notre humanité : la prudence, la justice, le doute, la retenue.
Car à vouloir tout anticiper, on finit par tuer pour ce qui n’a pas encore eu lieu.
Et dans ce monde où l’on assassine au nom du futur, le pire n’est peut-être plus à venir : il est déjà là.